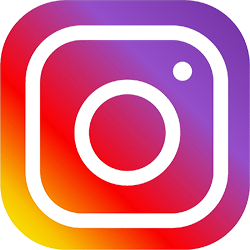Bienvenue à Vétroz
Actualités
Informations officielles
Fermeture Avenue des Vergers – 15 mai 2024
Les travaux sur l'Avenue des Vergers arrivent à leur terme. Afin de permettre la pose de l'enrobé définitif, la route doit être fermée à toute la circulation le ; Mercredi 15 mai 2024 de 8 h 00 à 17 h 00 Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation mise...
Chauffage à distance (CAD)
Rue Pré-FleuriTravaux actuellement en cours sur l'Avenue des Vergers.L'extension du réseau du chauffage à distance (CAD) se poursuit dans le village. Les utilisateurs sont priés de se conformer à la signalisation mise en place par l'entreprise en charge. Ce chantier...
Vétroz en mouvement – Cartes multicourses
Vétroz en mouvement Vétroz s’engage aux côtés de Car Postal pour la promotion des transports publics. Tous les ménages de notre commune ont reçu une lettre avec un bon pour une carte multicourses gratuite (Vétroz-Sion) à venir chercher au guichet communal...
Évènements
Vente de livres à la biblio de Vétroz – 22 mai 2024
Le Marché du livre est de retour, mercredi après-midi 22 mai 2024, à la biblio de Vétroz ! Venez nombreux farfouiller dans nos anciens stocks de documents à vendre à petits prix (Fr. 1.- pour la jeunesse et à Fr. 2.- pour les adultes) pour vos prochaines...
Découverte de l’Amigne – 25 mai 2024
Commission culturelle de Vétroz
Bulletin officiel
Parutions au bulletin officiel 26.04.2024
Vous trouverez ci-dessous les dernières parutions concernant Vétroz dans le Bulletin officiel
Parutions au bulletin officiel 12.04.2024
Vous trouverez ci-dessous les dernières parutions concernant Vétroz dans le Bulletin officiel
Parutions au bulletin officiel 8.04.2024
Vous trouverez ci-dessous les dernières parutions concernant Vétroz dans le Bulletin officiel